
LES 12/14 - INFO-DÉBATS
Le deuxième mardi du mois entre 12h15 et 13h45
Un Toit pour Tous organise avec ses partenaires un temps de rencontre, d’échange, d’information et de formation sur toutes les questions liées au mal-logement. Cet événement est ouvert et gratuit. Venez débattre avec nous !
À savoir
Les 12/14 du Toit sont des webinaires ouverts à tous. Il s’agit de temps d’échanges centrés sur le partage de connaissances et d’expériences ainsi que sur la présentation et la recherche de solutions pour lutter contre le mal-logement.
Chacun est libre de proposer un sujet qu’il souhaite voir traité : contact@untoitpourtous.org
Programme des prochains 12/14
Mardi 9 septembre : la demande d’asile et ses conséquences pour les personnes
Mardi 14 octobre : DALO/DAHO
Synthèses et replays
Des synthèses des 12/14 ont été rédigées jusqu’en 2021, date depuis laquelle les 12/14 sont disponibles en replays.
À LA UNE
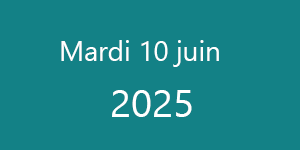
12h-14h
EN PRÉSENTIEL
Maison des associations de Grenoble
6 rue Berthe de Boissieux
Face aux suspensions et ruptures de droits engendrant des impayés locatifs : comment faire mieux ?
L’accès aux prestations sociales, conditionné à l’ouverture de droits, est nécessaire et vital pour une grande partie des ménages les plus en difficulté. Sans cela, le maintien d’un niveau de vie décent pour vivre est mis en péril.
Or, leurs parcours sont fréquemment marqués par des ruptures ou des suspensions de droits, qui ne sont ni toujours justifiées par les administrations en charge, ni anticipées par les bénéficiaires. Ces fluctuations dans l’octroi des aides ont des conséquences directes et graves pour les foyers concernés, dont les budgets sont déjà contraints et les trajectoires de vie complexes. En bout de chaîne, ces interruptions se répercutent rapidement sur la capacité à régler son loyer, générant parfois des impayés qui auraient pu être évités.
Comment faire face, le plus efficacement possible, à ces suspensions et ruptures de droits afin d’en minimiser les conséquences pour celles et ceux qui en ont le plus besoin et qui rencontrent pourtant les plus grandes difficultés pour y accéder ?
Invités à la table ronde :
- Marylène David, responsable activité contentieux, Actis
- Aude Moussaoui, travailleuse sociale, Un Toit Pour Tous
- Romain Mathieu, travailleur social, Un Toit Pour Tous
D’autres intervenants seront également présent en salle.
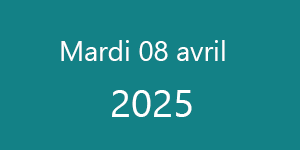
12h15-13h45
Webinaire
Favoriser l’accès à un logement locatif ou à la propriété pour les ménages modestes
Depuis une vingtaine d’années, le marché immobilier donne des signes de dérèglement : les prix de vente des biens immobiliers se sont envolés (+ 125,6 % entre 2001 et 2020), du fait notamment d’une survalorisation du foncier, tout comme ceux des loyers (+ 36,5 %, parc social et secteur libre confondus), qui connaissent une évolution supérieure à celle de l’inflation. De ce fait, le coût représenté par le logement pèse de plus en plus lourd dans le budget global des ménages, qui plus est dans celui des ménages les plus pauvres.
Face à cette explosion des prix immobiliers d’un côté et des loyers de l’autre – quand les revenus, parallèlement, augmentent bien moins vite – des outils de régulation du marché locatif et pour favoriser l’accession sociale à la propriété peuvent être mis en place, notamment par les collectivités territoriales. C’est le cas, parmi d’autres, du dispositif expérimental d’encadrement des loyers et de la création d’un organisme de foncier solidaire (OFS) permettant la mise en œuvre du bail réel solidaire (BRS).
Le 12-14 sera l’occasion de :
- Prendre connaissance des deux outils de régulation du marché par les collectivités territoriales que sont le dispositif d’encadrement des loyers (pour réguler le marché locatif), et la mise en œuvre d’un organisme de foncier solidaire (OFS) pour favoriser l’accession sociale à la propriété.
- Faire état et cerner les enjeux du contexte immobilier actuel dans l’aire grenobloise grâce aux données recueillies par l’Observatoire local des loyers (OLL).
Invités au débat :
- Vincent Daön, directeur du pôle Aménagement du territoire, Grenoble Alpes Métropole
- Déborah Sauvignet, cheffe de projet OLL (Observatoire local des loyers), Agence d’urbanisme de la région grenobloise

12h15-13h45
Webinaire
Handicap et perte d’autonomie : accélérateurs de vulnérabilités dans le parcours logement ?
Souvent invisibilisées dans le débat public et les politiques sociales, les personnes privées de domicile personnel en situation de handicap ou de perte d’autonomie rencontrent des obstacles supplémentaires qui exacerbent leur précarité.
La non-adaptation généralisée, tant du point de vue des équipements que des pratiques d’accompagnement, est notamment vectrice de difficultés pour l’accès ou le maintien de ces personnes à un habitat adapté à leurs besoins.
Choisir de traiter ce sujet, c’est donc s’intéresser d’abord aux besoins particuliers des personnes privées de domicile personnel (ou l’ayant été dans leur parcours) et en situation de handicap, mais également aux pratiques des professionnels qui les soutiennent dans leur parcours social et de soins.
Le 12-14 sera l’occasion de :
- Présenter des structures et dispositifs qui travaillent au quotidien en lien avec les problématiques de vieillissement et de handicap ;
- Identifier les bonnes pratiques pour améliorer la prise en charge des personnes ayant connu ou concernées par la privation de domicile personnel ;
- Aborder les principaux défis actuels liés à la privation de domicile personnel, en lien avec le vieillissement et le handicap.
Invités au débat :
- Pascal Bruneau, chargé de mission au sein de la plateforme VIP
- Léonore Boile et Yannis Bediat, coordination et mission Santé-Précarité au Réseau Social Rue Hôpital
LES 12/14 EN 2024
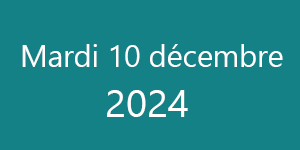
12h15-13h45
Webinaire
La coordination des accueils de jour fête ses 10 ans ! Quels retours du terrain concernant les situations des personnes en grande difficulté ?
Qu’est-ce qu’un accueil de jour ? Qui sont les personnes qui fréquentent ces espaces d’accueil et de socialisation ? Quels sont leurs besoins et que recherchent-elles au sein de ces structures ?
A l’occasion des 10 ans la Coordination des accueils de jour de l’Isère, ce 12-14 se propose de revenir sur ces structures originales et primordiales dans la vie des publics les plus précaires.
Diverses dans leurs fonctionnements, elles ont comme point commun d’être ouvertes à tous et d’offrir un accueil inconditionnel pendant la journée. En « bout de chaîne » de l’accueil, elles reçoivent un public de plus en plus nombreux et de plus en plus divers, tout en continuant à assurer des services de base (nourriture, hygiène), et pour certaines en proposant des permanences d’accès aux droits, mais aussi de la médiation sociale et de santé, et des activités culturelles.
Le 12-14 sera l’occasion de :
- Présenter concrètement le fonctionnement de plusieurs Accueils de jour : Alfa3a (Vienne), Le Rigodon (Voiron), Femmes SDF (Grenoble) et entendre leurs expériences du terrain.
- Balayer les grands enjeux qui se posent aujourd’hui dans l’accueil des populations les plus en difficulté.
Invités au débat :
- Julie Chatelet, Observatoire de l’hébergement et du logement – Un Toit Pour Tous
- Audrey Saurat, Le Rigodon (Voiron)
- Natalie Faure, Alfa3a (Vienne)
- Maïwenn Abjean, Femmes SDF (Grenoble)
- Jean-Claude Vial, animateur de la coordination des accueils de jour
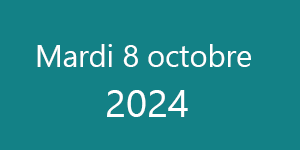
12h15-13h45
Webinaire
Refuser un logement DALO : comprendre les raisons et impacts pour les ménages
Pour les ménages qui y recourent, par bien des aspects – de la connaissance de leur droit à leur relogement potentiel, en passant par le dépôt de leur dossier et l’attribution d’un logement – le DALO est un parcours du combattant. On peut s’étonner alors que, en bout de parcours et une fois que l’ensemble des obstacles liés à la procédure ont pourtant été dépassés, un nombre non négligeable de ménages font le choix de refuser le logement qui leur est finalement proposé. Et en effet, ce taux de refus par les ménages des logements proposés par le BALD est largement supérieur en Isère (17 %) qu’il ne l’est nationalement (5 %) (en 2020) : près d’un ménage sur cinq est concerné localement.
C’est à partir de ce constat paradoxal que l’idée de ce 12-14 est née : refuser un logement après s’être battu pendant des mois pour se le voir proposer implique nécessairement des raisons motivées et sérieuses, qui feront donc l’objet de nos échanges.
Le 12-14 sera l’occasion de :
- Revenir sur les modalités d’attribution d’un logement dans le cadre d’un recours DALO ;
- Identifier les motifs de refus d’une proposition de logement et les impacts que ce refus peut avoir dans la trajectoire d’un ménage vis-à-vis du logement.
Invités au débat :
- Marie Guillaumin, Observatoire de l’hébergement et du logement – Un Toit Pour Tous
- Béatrice Leplan, responsable Département des demandes et attributions – Actis
- Lauren Watrin, Equipe juridique mobile – ville de Grenoble

12h15-13h45
Webinaire
Lutter contre l’indignité dans l’habitat, un combat de chaque jour
S’il est difficile de connaître l’ampleur exacte du phénomène, l’habitat non-décent et indigne est bel et bien présent sur le territoire national, et dans une mesure probablement assez conséquente – 600 000 logements du parc privé, au bas mot, seraient potentiellement indignes en France, d’après les estimations de la Fondation Abbé Pierre. A ceux-là s’ajoutent ceux du parc public, également touchés, bien que souvent à moindre intensité. Et l’Isère n’est pas épargnée par le phénomène.
Mais l’habitat indigne et non-décent ne s’arrête pas aux logements : l’indignité touche d’abord et avant tout les personnes qui la subissent. Vivre dans un logement non-décent ou indigne a de fortes répercussions sur l’ensemble de la vie quotidienne et est évidemment source d’un mal-être plus global. Ces effets néfastes s’imposent, le plus souvent, à des populations déjà précarisées et vulnérables, celles qui, n’ayant pas vraiment d’autres choix, sont contraintes d’accepter des logements dégradés ou ne peuvent pas partir quand le logement se dégrade.
Le 12-14 sera l’occasion de :
- Cerner les contours de l’habitat indigne et non-décent ;
- Entendre des acteurs institutionnels locaux et les dispositifs d’accompagnement qu’ils coordonnent ;
- Découvrir des initiatives locales originales.
Invités au débat :
- Stevie Riedinger, chargé de projet Mal-logement au Département de l’Isère
- Hélène Aurel, Soliha Isère-Savoie
- Jérôme Grand, responsable du service « Gestion du logement social et de l’hébergement » à Grenoble Alpes Métropole
- Grégoire Vincent, directeur du fonds solidaire et coopératif Travaux Suspendus
- Thomas Pedron-Trouve, Les Compagnons Bâtisseurs en Isère
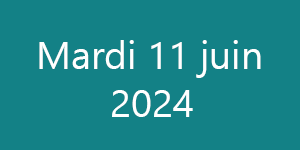
12h-13h30
EN PRÉSENTIEL
Maison des associations de Grenoble
6 rue Berthe de Boissieux
Comment mieux prévenir les expulsions locatives ? Agir sur les impayés de loyer.
En Isère, en 2022, on recensait près de 2 700 assignations au tribunal dans le cadre de la procédure d’expulsion : c’est 20 % de plus que 5 ans plus tôt.
Ce 12-14 propose de revenir aux fondements de la procédure d’expulsion, qui commence toujours avec un impayé de loyer (dans environ 95 % des cas) – bien que tout impayé ne conduise, lui, pas toujours à une procédure contentieuse.
Alors que le logement représente le 1er poste budgétaire dans le budget global des ménages – qui plus est chez les ménages les plus pauvres – il peut vite devenir difficile de régler cette charge, et davantage dans ce contexte actuel d’inflation. L’évolution du niveau des charges locatives ou des sources d’énergie (gaz, électricité) accentue les fragilités sociales des ménages, ce qui vient aggraver et multiplier les situations d’impayés.
Si l’impayé locatif n’est finalement qu’un phénomène très marginal, il n’en demeure pas moins préoccupant et source de violences pour ceux qui le subissent. C’est pourquoi il doit être pris en charge le plus tôt possible, pour éviter que la dette s’accroisse, car au fur et à mesure de son accroissement, les solutions pour la résoudre, elles, s’amenuisent.
Le 12-14 sera l’occasion :
- de mieux comprendre les raisons qui poussent les personnes à ne plus payer leurs loyers, et de ce fait, à risquer une expulsion de leur logement ;
- de revenir sur les différents procédures et dispositifs qui jonchent le parcours d’un ménage en situation d’impayés ;
- d’entendre des professionnels de terrain qui accompagnent les ménages.
Animation : Jean-François Lapière
Invités au débat :
Camille Cirgue, coordinatrice Action sociale au Pôle Inclusion Financière du CCAS de Grenoble ;
Véronique Gilet, directrice de l’agence régionale Auvergne-Rhône Alpes de la Fondation Abbé Pierre ;
Marie Guillaumin, chargée d’études à l’Observatoire de l’Hébergement et du Logement ;
Joël Manly, adjoint au Directeur départemental de L’Isère à la Banque de France de Grenoble
Mathilde Glabik, responsable du service Locatif et Social de l’agence de Fontaine Alpes Isère Habitat ;
Laëtitia Pontonnier, responsable du service Locatif et Social de l’agence d’Echirolles Alpes Isère Habitat.
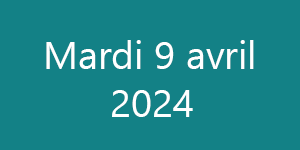
12h15-13h45
Webinaire
La privation de domicile personnel : une réalité banalisée ?
Le terme de « personne privée de domicile personnel » désigne toute personne sans-abri, en habitation de fortune, en dispositif d’accueil ou d’hébergement, ou en hébergement contraint chez un tiers. Cela couvre un ensemble de situations très précaires mais néanmoins variées, complexes et multiformes.
Cette diversité des parcours de vie et des publics ainsi que l’exclusion sociale qu’ils subissent rend le phénomène de privation de domicile personnel difficile à évaluer et à saisir. Cependant, malgré un manque de données chiffrées important sur ce sujet, tous les indicateurs disponibles indiquent une massification du phénomène et une dégradation de la situation en France, l’Isère ne faisant pas exception… Cela se confirme localement, d’après les remontées de terrain des différents acteurs, institutionnels ou associatifs, qui œuvrent auprès de ces publics fragilisés.
Le 12-14 sera l’occasion :
- de revenir sur les éléments de cadrage autour de la privation de domicile personnel ;
- d’insister sur la diversité des publics concernés ;
- d’entendre les témoignages de professionnels de terrain et en lien direct avec les personnes ;
- d’élargir la question de la privation de domicile personnel à la difficulté d’accès aux biens primaires tels que l’alimentation.
Invités au débat :
- Benoît Bacher – Observatoire de l’Hébergement et du Logement
- Dominique Flandin-Granget – Accueil Migrants Grésivaudan
- Pierre-Luc Fayolle – CCAS d’Echirolles
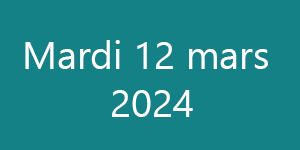
12h15-13h45
Webinaire
De la rue au logement : quels enseignements retenir de l’expérience de Totem ?
« De la rue au logement », c’est l’axe conducteur de la politique dite du Logement d’Abord, dont le deuxième plan quinquennal s’est ouvert en 2023. Le dispositif Totem, porté par le Relais Ozanam, l’Oiseau Bleu, le centre de soins infirmiers Abbé Grégoire, Un Toit Pour Tous, et l’Equipe Mobile de Liaison Psychiatrique Précarité, se déploie localement depuis 2012, à Grenoble, en accord avec l’esprit de cette politique publique, bien avant sa mise-en œuvre accélérée sur le territoire métropolitain.
Le service met en place un accompagnement médico-social en multiréférence, en s’appuyant sur une approche de réduction des risques, pour favoriser et permettre l’accès à un logement durable des publics qualifiés de « grands exclus ». Plus particulièrement, le dispositif prend en charge des personnes qui, pour divers motifs (alcoolisme, toxicomanie, propriétaires de chiens, problèmes de comportements antérieurs, etc.), n’accèdent pas ou plus aux dispositifs d’hébergement « traditionnels ». Depuis juillet 2015, Totem accompagne 25 personnes, en file active, dans le cadre de ses missions principales, et ce sans limite de temps ni contractualisation.
Le 12-14 sera l’occasion :
- de présenter le fonctionnement, les missions et le bilan de Totem ;
- de tirer les enseignements et les enjeux de cette expérimentation, déjà ancienne ;
- de revenir sur les pratiques mises en œuvre par l’association dans l’accompagnement de personnes très fragilisées.
Invités au débat :
- Maureen Perret-Depiaz, éducatrice spécialisée au sein du service Totem
- Lionel Thibaud, responsable de service Totem
- Richard Diot, directeur de Point d’Eau
- Autres intervenants à confirmer

